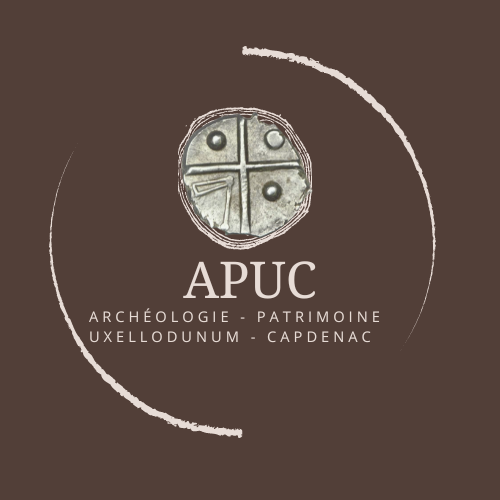Pourquoi Uxellodunum.fr ?
Capdenac-le-Haut est le site actuel qui correspond le mieux aux descriptions du site Gaulois d’Uxellodunum.
En 51 avant J.C., après la chute d’Alésia, deux chefs gaulois, Lucterios (du Quercy) et Drappès (de Sens), s’unissent pour continuer la résistance contre les Romains. Pressés par les légions de Jules César, ils s’enferment avec 2 000 combattants dans une place forte aux confins du Quercy (Uxellodunum) où ils résistent plusieurs mois aux assauts de 30 000 légionnaires commandés par César lui-même…

Pourquoi Uxellodunum.fr ?
Capdenac-le-Haut est le site actuel qui correspond le mieux aux descriptions du site Gaulois d’Uxellodunum.
En 51 avant J.C., après la chute d’Alésia, deux chefs gaulois, Lucterios (du Quercy) et Drappès (de Sens), s’unissent pour continuer la résistance contre les Romains. Pressés par les légions de Jules César, ils s’enferment avec 2 000 combattants dans une place forte aux confins du Quercy (Uxellodunum) où ils résistent plusieurs mois aux assauts de 30 000 légionnaires commandés par César lui-même…

Les dernières nouvelles de l’APUC et d’Uxellodunum
Profitez de la fraîcheur de notre musée, des nombreuses pièces […]
Suivez nos actualités !
Inscrivez-vous gratuitement à notre lettre d’information et recevez dans votre boîte mail nos mises à jour, annonces et actualités du site Uxellodunum.fr !